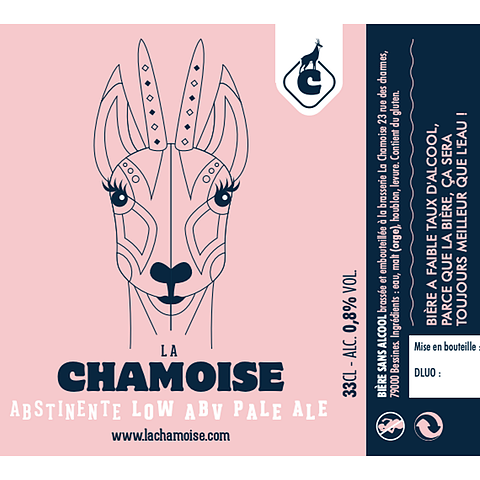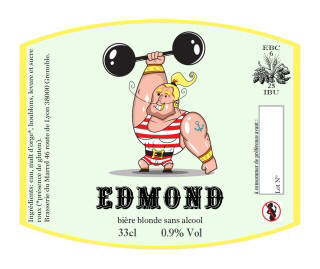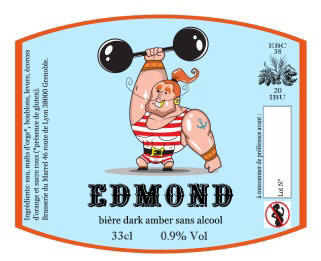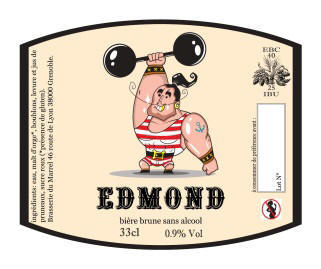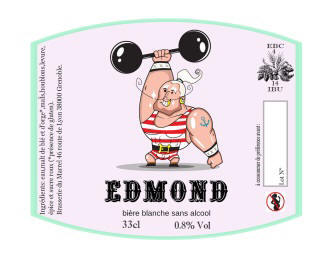|
Bières sans alcool ou
faiblement alcoolisées Une chose est certaine, les mentalités changent et les consommateurs recherchent dans certaines occasions une bière savoureuse et peu alcoolisée, pauvre en alcool ou sans alcool. Les nouvelles méthodes de production et l'évolution de l'air du temps contribuent à la popularité de ce segment. Il y a une prise de conscience croissante par rapport à la santé, surtout au sein de la jeune génération qui consomme moins d'alcool. Même les boissons gazeuses sucrées sont de plus en en plus contestées.
Bières sans alcool… En France, la dénomination "bière sans alcool" est réservée à la bière qui présente un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 1,2 % en volume. Cette législation autorise donc d'apposer la mention "sans alcool" pour un produit titrant en réalité 1,2% d'alcool en volume. De quoi apporter de la confusion chez les consommateurs. Aussi, les grands groupes industriels qui multiplient ces deux dernières années les références réellement sans alcool, le spécifient dans le nom de leurs produits : Carlsberg 0.0%, Heineken 0.0 ou autre Hoegaarden 0.0. On constate ainsi qu'un grand pas a été franchi. Ce ne sont plus des gammes distinctes qui portent le drapeau des bières sans alcool (Tourtel, Buckler, Panach,…), mais bien les marques phares des brasseurs elles-mêmes. En associant directement leurs produits vedettes à ce segment, les industriels montrent ainsi la confiance qu'ils portent dans ce secteur. Après le lancement de Hoegaarden 0.0% en tant que première bière blanche sans alcool en 2011 et celui de la Jupiler 0.0% en 2016, le leader mondial AB InBev élargit sa gamme en janvier 2019 avec la toute première bière d'abbaye sans alcool Leffe Blonde 0.0% en Belgique. Une bière d'abbaye sans alcool?! Certains crieront au sacrilège. Le brasseur veut faire en sorte que, d'ici à la fin de 2025, au moins 20 % du volume mondial de sa bière soit constitué de bières non alcoolisées ou faiblement alcoolisés[1]. Et le numéro deux mondial, le groupe néerlandais Heineken, semble lui donner raison en lançant en avril 2019 sur le marché français son Affligem 0.0. Lors de leur conférence de presse annuelle du 15 mars 2019, le groupe annonçait que la marque Heineken 0.0 détenait 25,4 % de part de marché sur le segment des lagers sans alcool, après deux ans de commercialisation. Le brasseur investit également 6 millions d’euros dans sa brasserie alsacienne de Schiltigheim, afin de porter sa capacité de production à 20 millions de litres d’Heineken 0.0[2]. Le groupe Carlsberg, qui rappelons-le est propriétaire de Kronenbourg en France, annonce détenir 70% du marché français de la bière sans alcool (hors panachés)[3]. Ces bons indicateurs poussent le groupe à multiplier les références sans-alcool, de dégustation ou aromatisées : celles-ci pèsent 29,2% des ventes, contre 21,2% en 2015 et 10,2% en 2010.
En juin 2020, le Club des Ami.e.s de la Bière a réalisé un recensement des bières sans alcool françaises pour les brasseries artisanales. Une manière originale de faire une photographie de ce secteur en pleine expansion : https://clubamiesbiere.home.blog/2020/06/10/les-bieres-craft-sans-alcool-en-france En mars 2021, la Brasserie de Bretagne est la première de la région à se lancer sur ce créneau. Elle propose deux références titrant 0,0% sous les dénominations Ar-Men Blonde et Dremmwel. La brasserie précise que "le procédé de brassage limite la quantité de sucres naturellement présents dans les céréales. Puis est réalisée une désalcoolisation par centrifugation : l’alcool est ainsi évaporé à basse température et sous vide".
Les bières sans alcool montrent donc une grosse marge de progression dans l'hexagone. En 2017, la part de marché de ce segment était de 2%. En 2018, ce chiffre grimpait à 2.7%[4], tandis que Brasseurs de France avançait même une part de marché de 5.5% en mai 2019, soit environ 2 litres par an par habitant[5]. En contradiction avec cette tendance de fond, le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume affirmait cependant en janvier 2019 que le vin n’était "pas un alcool comme les autres"…
… ou pauvre en alcool Les microbrasseries ne sont pas insensibles à cette tendance. Mais les investissements étant souvent importants pour produire une bière réellement sans alcool, les petits brasseurs surfent plutôt sur la mode des bières faiblement alcoolisées. Durant de nombreuses années, les bières de spécialités ont en effet souvent été apparentées à des produits assez alcoolisés. Pourtant, on distingue actuellement une nette tendance à la production de bières légères, portées par la mode anglo-saxonne des "Session". On constate ainsi l'arrivée sur le marché de nombreuses bières goûteuses aux alentours de 3% d'alcool en volume. Il peut s'agit de light ales, de session pale ale ou encore de bières de table. De plus, les brasseurs se trouvent ainsi avantagés par un taux d'accise plus faible.
Et à l'étranger? Aux États-Unis, les bières à faible teneur en alcool ont la cote, contrairement à l’Europe, où ce sont plutôt les bières sans alcool. L'Espagne est le pays européen qui bat le record de consommation de bière zéro alcool, avec 18% des parts de marché! En Allemagne, le segment des sans alcool qui représente 6% de part de marchés, est complété de manière traditionnelle par les radlers, un mélange de bière et de limonade en référence aux cyclotouristes. Mais si vous voulez rouler serein, vous pouvez aussi compter sur un "BMW" (Beer Mit Wasser), qui combine bière et eau minérale pétillante.
Au Royaume-Uni, alors même que les traditionnels Bitter, Mild et autre Porter affichent des taux d'alcool autour de 4%, la demande de bière et de cidre contenant moins de 1,2% d'alcool a bondi de plus de 28% en volume en 2017. Signe du temps, l'édition 2018 du fameux "Great British Beer Festival" a proposé pour la première fois de son histoire des bières sans alcool. L'Irlande a même ouvert en mai 2019 à Dublin son premier pub… sans alcool! La fameuse Guinness y est ainsi remplacée par un "Nitro coffee", boisson crémeuse, foncée et glacée servie à la pression.
Les technologies employées Le fait que la bière sans alcool soit maintenant plus appréciée qu’il y a environ trente ans est lié aux nouvelles méthodes de production. La méthode historique consiste à arrêter la fermentation de manière précoce, afin que les sucres présents ne soient qu'à peine convertis en alcool. Cette fermentation courte permet de créer une bière douce et maltée, contenant un taux d'alcool inférieur à celui autorisé par la législation pour une bière sans alcool. La distillation sous vide laisse cette fois la fermentation se poursuivre jusqu'à son terme. On procède ensuite à la désalcoolisation du produit fini par chauffage. Le point d'ébullition de l'éthanol étant de 78.4 °C, il conviendrait de chauffer la bière juste au-dessus de cette température afin de laisser l'alcool s'évaporer. Mais avec ce procédé, le goût de la bière est altéré. Aussi, la distillation de l'alcool est plutôt réalisée sous vide poussé (moins de 0.1 bar), afin de diminuer le point d'ébullition de l'éthanol. On atteint ainsi le résultat escompté à des températures inférieures à 60°C. Cette distillation est précédée par une décarbonatation sous vide lors de laquelle les arômes les plus volatils sont entraînés et partiellement récupérés. Cette fraction sera réinjectée sous pression après la distillation de l'alcool, afin de recarbonater la bière. Un tel procédé est par exemple décrit dans le brevet européen EP0560712A1[6]. Dans ce cas également, il peut rester un peu d'alcool résiduel dans le produit fini. La filtration sur membranes par osmose inverse est de nos jours fréquemment employée. On met la bière dans une cuve, puis on lui fait subir une forte pression (par exemple à l'aide d'une centrifugeuse) afin qu'elle passe à travers une membrane organique semiperméable qui va laisser sortir l'eau et l'alcool, tandis que les sucres et les autres matières premières se concentrent en formant ainsi un sirop. Il suffit ensuite d'ajouter de l'eau au sirop à la même concentration que celle perdue lors de la filtration pour obtenir une bière sans alcool qui n'aura pas été soumise à la chaleur et conserve toute sa fraicheur. L'extraction à l'aide d'adsorbants hydrophobes[7] semble être une méthode plus confidentielle. L'alcool présent dans la bière fermentée est extrait à l'aide d'adsorbants hydrophobes, plus particulièrement des silices hydrophobes ou des silico-aluminates zéolitiques hydrophobes. Enfin, la recherche sur les levures non productrices d'alcool bat son plein. Par exemple, la levure Kluyveromyces thermotolerans, non-saccharomyces, dispose d'un métabolisme qui produit de l'acide lactique en lieu et place de l'éthanol. La souche Lachancea thermotolerans[8] est également une bonne alternative pour la production de bière sans alcool. Il est également possible d'utiliser la levure Saccharomyces Ludwigii, présentant une faible atténuation, et donc une capacité moindre à transformer le sucre en alcool. Quelle que soit la méthode choisie, voici quelques procédés utilisés pour produire une bière sans alcool qui aura suffisamment de corps et de complexité gustative :
[1] Source : https://ab-inbev.be/fr_BE/news/leffe-blonde-00--la-toute-premiere-biere-dabbaye-sans-alcool-en-belgique# [2] Source : Rayon Boissons (15 mars 2019) [3] Source : L'Usine Nouvelle (20 mars 2019) [4] Source : Rayon Boissons (mars 2018) [5] Source : Brasseurs de France (communiqué de presse du 21 mai 2019) [6] https://patents.google.com/patent/EP0560712A1 [7] https://patents.google.com/patent/EP0486345B1/fr [8] Lachancea thermotolerans as an alternative yeast for the production of beer (Journal of The Institute of Brewing, volume 122 numéro 4, pages 599 à 604) |